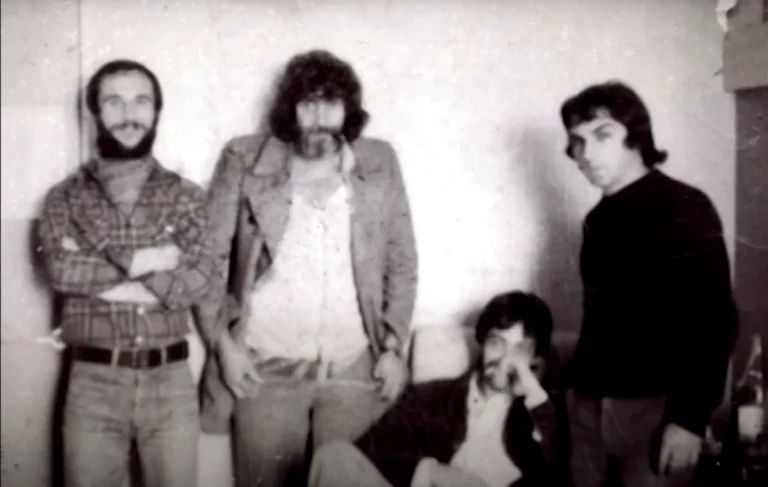Du rejet au renouveau : le nationalisme entre diabolisation et résurgence
Le mot « nationalisme » suscite immédiatement la méfiance. Chargé d’un poids historique écrasant, il est associé dans l’inconscient collectif aux pires tragédies du XXᵉ siècle : guerres mondiales, fascisme, totalitarismes. En France, il est même devenu un tabou, un repoussoir absolu, réduit à une caricature de haine et d’exclusion. Pourtant, ce rejet total du nationalisme est une exception dans le monde : aux États-Unis, en Russie, en Chine, en Inde, ou même dans de nombreux pays européens, il est revendiqué sans honte, perçu comme une fierté naturelle et un ciment essentiel des sociétés.
Mais alors, le nationalisme est-il intrinsèquement mauvais ? Peut-on faire la différence entre un nationalisme sain, protecteur, et un nationalisme belliqueux et destructeur ? Et surtout, pourquoi assiste-t-on aujourd’hui à son retour, après des décennies de règne sans partage du mondialisme et du supranationalisme ?
Cet article propose d’explorer l’histoire du nationalisme sous toutes ses facettes, en commençant par la période charnière de l’entre-deux-guerres, où il a pris des formes aussi variées que contradictoires. Puis, nous verrons comment il s’est transformé, diabolisé après 1945, avant de renaître aujourd’hui sous une forme nouvelle, portée par le rejet de la mondialisation et la crise identitaire des peuples européens.
Le nationalisme entre les deux guerres mondiales : entre protection et expansion
La Première Guerre mondiale devait être la « der des ders ». Pourtant, à peine deux décennies plus tard, l’Europe replonge dans un conflit encore plus dévastateur. Entre ces deux guerres, le nationalisme joue un rôle central, mais sous des formes très différentes selon les pays. Si certains États l’adoptent comme un réflexe défensif face à la mondialisation naissante et aux humiliations de l’Histoire, d’autres en font un instrument de conquête et de domination.
L’explosion des nationalismes après 1918 : la revanche des nations
L’armistice de 1918 marque la chute des grands empires continentaux : allemand, austro-hongrois, ottoman et russe. Une mosaïque de nouveaux États émerge en Europe centrale et orientale, portés par des revendications nationalistes longtemps étouffées. La Pologne retrouve son indépendance, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie apparaissent sur la carte, et l’Empire ottoman se rétracte pour donner naissance à la Turquie moderne.

Ces nouvelles nations se construisent autour d’un nationalisme identitaire fort, visant à préserver leur souveraineté et leur culture face aux influences extérieures. Mais ce processus s’accompagne aussi de tensions, notamment en raison des minorités ethniques présentes dans ces nouveaux États : Allemands des Sudètes en Tchécoslovaquie, Hongrois en Roumanie et Slovaquie, Polonais en Lituanie… Autant de bombes à retardement qui éclateront plus tard.
Le nationalisme défensif : un rempart contre le chaos
Dans les pays vainqueurs comme la France et le Royaume-Uni, le nationalisme prend une forme plus conservatrice. Marqués par les sacrifices de la guerre, les Français développent un patriotisme centré sur la défense de leur territoire et de leur culture. Le nationalisme y est synonyme de protection, notamment face à la montée du communisme soviétique et aux menaces économiques d’une mondialisation balbutiante.
En Hongrie, amputée des deux tiers de son territoire par le traité de Trianon (1920), le nationalisme devient un cri de douleur, une quête de justice face à ce qui est perçu comme une humiliation historique. Ce sentiment d’injustice nourrit un ressentiment profond qui pèsera sur la politique du pays dans les années suivantes.
Le nationalisme expansionniste : le mythe de la grandeur retrouvée
Ailleurs, le nationalisme se radicalise et se mue en une idéologie conquérante. En Italie, Mussolini ressuscite le rêve d’un Empire romain et prône un nationalisme agressif qui aboutira à l’invasion de l’Éthiopie (1935) et à l’intervention dans la guerre d’Espagne.
En Allemagne, le nazisme détourne le nationalisme pour en faire un outil de domination raciale et territoriale. Hitler exploite le ressentiment né du traité de Versailles, qui a humilié l’Allemagne en lui imposant de lourdes réparations et en réduisant drastiquement son armée. Son discours vise à restaurer la grandeur allemande en revendiquant des territoires perdus et en éradiquant ce qu’il considère comme des menaces internes (Juifs, communistes, opposants politiques).
Ce nationalisme expansionniste et agressif est celui qui restera dans les mémoires, éclipsant les autres formes de nationalisme plus modérées. C’est lui qui servira d’épouvantail après 1945, menant à une diabolisation globale du concept même de nationalisme.
L’après-1945 : le nationalisme diabolisé
L’année 1945 marque une rupture radicale dans la perception du nationalisme. L’horreur de la Seconde Guerre mondiale, les crimes nazis et l’utilisation du nationalisme comme moteur de guerre ont discrédité cette idéologie aux yeux du monde occidental. Désormais, nationalisme et bellicisme sont synonymes, et la communauté internationale s’emploie à enterrer cette notion, jugée responsable des pires atrocités du siècle.
Le verdict de l’Histoire : « le nationalisme, c’est la guerre »
Après la guerre, l’Europe occidentale se reconstruit sous le signe du pacifisme et du multilatéralisme. L’Allemagne, l’Italie et le Japon sont mis sous tutelle et leurs anciennes velléités nationalistes sont éradiquées à coups de programmes de « dénazification » et de « dépacification ». En France, la phrase choc de François Mitterrand – « Le nationalisme, c’est la guerre » – deviendra un mantra officiel.

Ce rejet du nationalisme est amplifié par la construction européenne, qui se donne pour mission d’éviter tout retour des conflits nationalistes. Les institutions supranationales comme l’ONU et la CEE (future UE) promeuvent une vision du monde basée sur l’interdépendance économique et politique, avec l’idée qu’un monde sans frontières est un monde sans guerre.
L’émergence du mondialisme : la fin des nations ?
Dans la seconde moitié du XXe siècle, une nouvelle idéologie s’impose : le mondialisme. L’idée est simple : la paix passe par l’abandon progressif des souverainetés nationales au profit d’instances supranationales. Ce projet est d’abord présenté comme pragmatique : en rendant les nations économiquement dépendantes les unes des autres, on éviterait tout retour des guerres nationalistes.
Mais rapidement, le mondialisme devient une doctrine à part entière, défendue par les élites économiques et politiques occidentales. On promeut un monde sans frontières, où les États-nations deviennent obsolètes, remplacés par des grandes entités économiques et culturelles homogènes.
Le nationalisme est alors diabolisé et associé au fascisme. Dans les médias, dans l’éducation, dans la culture dominante, toute revendication nationaliste est immédiatement disqualifiée comme « dangereuse » ou « nauséabonde ». Cette assimilation systématique à l’extrême droite aboutit à un paradoxe : alors que le patriotisme est exalté partout ailleurs dans le monde (États-Unis, Chine, Russie, Inde, etc.), en France et en Europe de l’Ouest, il devient suspect.
Mais pendant ce temps, ailleurs…
Ce rejet du nationalisme est une exception occidentale. Partout ailleurs, il prospère et sert de moteur à l’essor des nations.
- Aux États-Unis, le patriotisme est une religion civique : le drapeau est omniprésent, l’hymne national est chanté dans les écoles, et les présidents parlent sans complexe de la « nation américaine ».
- En Russie, Poutine a bâti son pouvoir sur un nationalisme assumé, présenté comme un rempart contre l’Occident décadent.
- En Chine, le Parti communiste s’appuie sur un nationalisme économique et culturel pour asseoir son influence.
- En Inde, en Turquie, au Brésil, des leaders nationalistes ont émergé, revendiquant un retour aux racines culturelles et une affirmation de la souveraineté face à l’Occident.
Pendant que l’Occident se méfie du nationalisme, le reste du monde l’adopte et l’utilise pour se renforcer. Ce contraste va devenir de plus en plus frappant avec la montée des crises économiques et identitaires en Europe.
Le retour du nationalisme aujourd’hui : entre rejet de la mondialisation et crise identitaire
Après des décennies d’endormissement sous le règne du mondialisme, le nationalisme connaît un spectaculaire retour en force. De Donald Trump à Viktor Orbán, du Brexit au Rassemblement National, des protestations contre l’Union européenne aux revendications identitaires locales, l’ère du « sans-frontiérisme » vacille sous les coups de boutoir d’un nationalisme renaissant. Mais pourquoi ce revirement ? Quels sont les moteurs de ce retour ?
Le rejet de la mondialisation : le réveil des souverainetés
La promesse du mondialisme était belle : un monde unifié, sans guerres, où l’économie et la libre circulation remplaceraient les tensions entre nations. Mais à l’épreuve des faits, ce rêve s’est fracassé sur plusieurs réalités :
- La désindustrialisation massive de pays occidentaux, devenus dépendants de la Chine et des marchés financiers.
- L’érosion des États-nations, qui voient leur pouvoir dilué au profit d’organisations supranationales (UE, ONU, FMI).
- Les inégalités croissantes, avec une élite mondialisée ultra-mobile et des classes populaires laissées pour compte.
- Le sentiment de dépossession démocratique, notamment en Europe, où les décisions majeures échappent de plus en plus aux peuples.

Face à cette impasse, le nationalisme revient comme une réponse évidente : reprendre le contrôle, restaurer la souveraineté, redonner du poids aux nations face à des instances jugées lointaines et technocratiques.
La crise identitaire : qui sommes-nous encore ?
Le deuxième moteur du retour du nationalisme est identitaire. Depuis plusieurs décennies, les sociétés occidentales subissent une transformation culturelle et démographique accélérée sous l’effet de l’immigration de masse, du multiculturalisme et du rejet des traditions nationales.
Les débats sur « l’identité nationale », autrefois marginaux, deviennent centraux :
- Peut-on encore parler d’une culture française, anglaise, italienne, dans des sociétés de plus en plus métissées ?
- Le roman national doit-il être réécrit pour correspondre aux nouvelles réalités ethniques et culturelles ?
- Le modèle d’assimilation à la française est-il dépassé, face à une diversité qui ne veut pas forcément s’intégrer ?
Ces questions, longtemps méprisées par les élites, explosent aujourd’hui sur le devant de la scène. La montée des tensions communautaires, le rejet de l’histoire nationale dans les écoles, les accusations de « racisme systémique » : tout cela nourrit un nationalisme de réaction, porté par ceux qui refusent la dilution de leur identité.
La recomposition des clivages politiques : un nationalisme transpartisan
Autre phénomène marquant : le nationalisme n’est plus une affaire exclusivement « d’extrême droite ». Il séduit désormais des franges de la gauche souverainiste, du gaullisme social, voire d’une partie des écologistes qui prônent un localisme radical contre la mondialisation.
De plus en plus, on assiste à une recomposition politique où le clivage « nationalistes vs mondialistes » remplace progressivement l’ancien clivage gauche-droite. Ce phénomène explique l’essor des partis dits « populistes » en Europe et ailleurs : ils incarnent la révolte contre l’effacement des nations et des peuples.
Conclusion – Vers un nationalisme rationnel ?
Le nationalisme est-il une fatalité ou une nécessité ? Pendant des décennies, il a été rejeté comme une idéologie dangereuse, synonyme de guerre et d’intolérance. Pourtant, son retour sur le devant de la scène prouve qu’il répond à un besoin profond : celui des peuples de préserver leur identité, leur souveraineté et leur continuité historique.
Mais comme toute force politique et culturelle, le nationalisme a ses dangers. Mal dosé, il peut virer à l’agressivité, à l’exclusion, à l’hostilité envers l’autre. La clé est donc de l’envisager de manière rationnelle : un nationalisme de protection, et non de domination. Un nationalisme qui ne renie pas l’ouverture au monde, mais qui rappelle que l’amour de son pays et de sa culture est une valeur légitime et fondamentale.
L’avenir nous dira si ce réveil nationaliste accouchera d’une nouvelle ère de conflits, ou si au contraire, il permettra aux nations de retrouver un équilibre face aux excès d’un mondialisme déracinant. Mais une chose est sûre : il ne disparaîtra pas. Car au fond, le nationalisme est peut-être tout simplement l’expression politique d’un instinct universel et intemporel : celui de la préservation de son propre foyer.