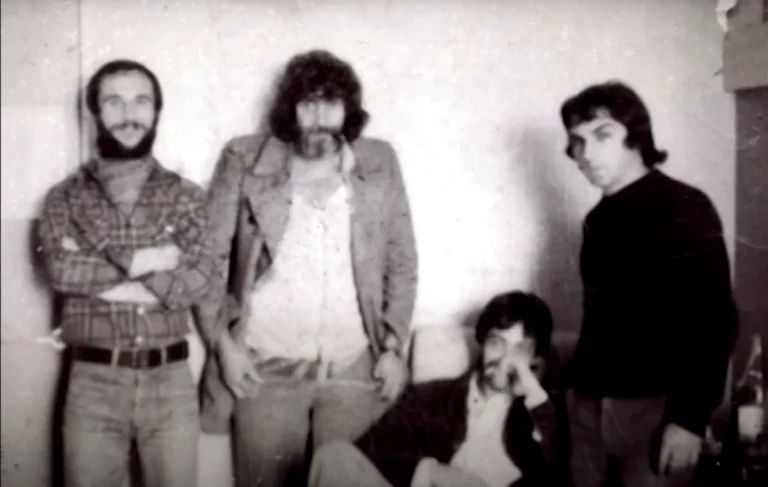Le souverainisme : une alternative pour la France face à la mondialisation
Le souverainisme, bien plus qu’un simple courant politique, est une posture philosophique et stratégique qui défend l’indépendance des nations face aux forces de la mondialisation et aux institutions supranationales. En France, il trouve un écho particulier dans le contexte d’une intégration européenne toujours plus poussée, perçue par certains comme un abandon progressif de la souveraineté populaire.
Cette réflexion a été largement portée par des intellectuels et penseurs critiques du projet européen tel qu’il s’est construit depuis le traité de Maastricht (1992) et, plus encore, depuis le traité de Lisbonne (2007), souvent considéré comme une trahison du vote populaire exprimé lors du référendum de 2005. Parmi eux, Michel Onfray s’impose aujourd’hui comme l’une des voix les plus influentes du souverainisme français. Son engagement s’est concrétisé avec la création de la revue Front Populaire, un espace de débat où se croisent des sensibilités diverses autour d’un même objectif : redonner à la France les moyens de son autonomie politique, économique et culturelle.
Alors que de nombreux pays revendiquent aujourd’hui une politique souverainiste – du Royaume-Uni avec le Brexit à la Hongrie de Viktor Orbán – la question se pose : le souverainisme est-il la réponse aux défis que traverse la France ? Cet article propose d’explorer ce courant à travers l’analyse de ses fondements, de sa place dans la pensée de Michel Onfray et des exemples internationaux qui en illustrent les enjeux.
Genèse et principes du souverainisme
Origines historiques et définition
Le souverainisme puise ses racines dans un concept fondamental : la souveraineté, définie dès le XVIᵉ siècle par le philosophe Jean Bodin comme « le pouvoir absolu et perpétuel d’une République ». Ce principe, qui fonde l’autorité de l’État, a été consacré par la Révolution française et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui affirme que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation ».
À partir du XXᵉ siècle, le souverainisme se structure en réponse à deux grandes évolutions : la montée des institutions supranationales et la mondialisation. L’Union européenne, avec son projet d’intégration politique et économique, est perçue par certains comme une dépossession progressive de la souveraineté des États au profit d’entités bureaucratiques non élues.
Ainsi, le souverainisme moderne ne se limite pas à une simple nostalgie du passé ou à une opposition systématique à l’Europe : il incarne une revendication politique visant à préserver l’indépendance des décisions nationales en matière de législation, d’économie, de diplomatie et de contrôle des frontières.
Le souverainisme en France
En France, le souverainisme a longtemps été porté par le général de Gaulle, qui voyait dans l’indépendance nationale un principe intangible. Son refus d’intégrer la France dans l’OTAN en 1966 ou sa critique de la supranationalité européenne en sont des exemples emblématiques.
Dans les années 1990, la signature du traité de Maastricht marque un tournant : en instaurant une monnaie unique et en renforçant les pouvoirs de Bruxelles, il suscite une opposition farouche de plusieurs figures politiques, à gauche comme à droite. Jean-Pierre Chevènement, homme de gauche attaché à la souveraineté populaire, s’oppose alors violemment à ce qu’il considère comme une « dérive fédéraliste » de l’Union européenne. À droite, Philippe Séguin et Charles Pasqua défendent une vision gaulliste de la souveraineté, refusant toute dilution de l’autorité nationale dans un ensemble européen jugé technocratique.
Le référendum de 2005, où le « non » au Traité établissant une Constitution pour l’Europe l’emporte à 55 %, est une autre illustration de la défiance souverainiste. Pourtant, le traité de Lisbonne, ratifié en 2007 par voie parlementaire sous Nicolas Sarkozy, contourne ce vote populaire, renforçant encore la critique d’une Europe imposée contre la volonté des peuples.
Aujourd’hui, le souverainisme ne se cantonne plus à une seule famille politique. De François Asselineau à Florian Philippot en passant par Front Populaire et certains intellectuels de gauche comme Emmanuel Todd, il rassemble des sensibilités différentes, toutes convaincues que la souveraineté nationale est un enjeu essentiel pour préserver la démocratie et l’identité française.
Michel Onfray, Paul Melun et le renouveau souverainiste
Le souverainisme intellectuel de Michel Onfray
Michel Onfray s’est imposé comme l’un des penseurs majeurs du souverainisme contemporain en France. Connu pour sa critique virulente du néolibéralisme et de la technocratie européenne, il défend une vision du souverainisme qui ne se limite pas aux frontières nationales, mais englobe également une souveraineté culturelle et philosophique.
Selon lui, l’Union européenne, loin d’être une alliance des peuples, est devenue un carcan où la souveraineté démocratique des nations est progressivement dissoute au profit d’une gouvernance bureaucratique et éloignée du terrain. Il voit dans ce processus une dépossession du pouvoir populaire, notamment depuis la ratification du traité de Lisbonne en 2007 contre la volonté exprimée par référendum en 2005.
Revendiquant une approche transpartisane, Onfray tente d’unifier différentes traditions du souverainisme : du gaullisme de résistance au socialisme républicain, en passant par un certain attachement aux racines culturelles et historiques de la France. Il considère le souverainisme non comme un repli nationaliste, mais comme une nécessité pour préserver une démocratie authentique et un modèle social équilibré.
C’est dans cet esprit qu’il a lancé en 2020 la revue Front Populaire, qui se veut un laboratoire d’idées souverainistes réunissant des intellectuels de diverses sensibilités, de la gauche républicaine à la droite gaulliste.
Paul Melun et Souverains demain! : une nouvelle génération souverainiste
Si Michel Onfray incarne une vision philosophique et historique du souverainisme, une nouvelle génération d’intellectuels et d’essayistes, à l’image de Paul Melun, renouvelle le discours en l’adaptant aux enjeux du XXIᵉ siècle.
Paul Melun, essayiste et consultant en communication, a émergé ces dernières années comme une figure montante du souverainisme. À travers ses interventions médiatiques et ses ouvrages, il défend une vision pragmatique et enracinée du souverainisme, qui ne se réduit pas à une opposition à l’Union européenne, mais englobe des dimensions économiques, sociales et culturelles.
Il est notamment à l’origine du collectif Souverains demain!, qui se veut un espace de réflexion et de propositions politiques pour une France souveraine. À la différence d’un souverainisme parfois perçu comme nostalgique ou défensif, Paul Melun met l’accent sur une souveraineté proactive, capable de répondre aux défis contemporains :
- Souveraineté économique, en promouvant la réindustrialisation et la relocalisation des productions stratégiques.
- Souveraineté énergétique, en défendant une indépendance vis-à-vis des marchés internationaux.
- Souveraineté culturelle, en valorisant l’identité et l’héritage français face à une mondialisation jugée uniformisante.
Le travail de Melun et de Souverains demain! s’inscrit ainsi dans un renouveau du souverainisme, qui ne se contente plus d’une critique de l’Europe, mais cherche à proposer une alternative crédible et moderne aux politiques actuelles.
Une recomposition politique autour du souverainisme
Avec Front Populaire et Souverains demain!, on assiste à une diversification du souverainisme en France. Longtemps cantonné aux sphères gaullistes et chevènementistes, ce courant s’ouvre désormais à un public plus large, porté par des intellectuels qui transcendent les clivages partisans.
Loin d’être un mouvement monolithique, il réunit aujourd’hui des sensibilités diverses, allant du souverainisme économique prôné par Paul Melun au souverainisme civilisationnel défendu par Michel Onfray. Cette pluralité témoigne d’un besoin profond de réaffirmer la capacité des nations à décider par elles-mêmes, dans un monde où les grandes décisions semblent de plus en plus confisquées par des entités supranationales.
Face aux crises actuelles – tensions géopolitiques, dépendance économique, défis énergétiques – le souverainisme s’affirme ainsi comme une réponse possible, capable de redonner aux peuples la maîtrise de leur destin.
Exemples internationaux de souveraineté assumée
Le souverainisme n’est pas une spécificité française. Partout dans le monde, des États revendiquent leur indépendance politique et économique face aux institutions supranationales et aux dynamiques globalistes. Si chaque pays adopte une approche qui lui est propre, certains exemples illustrent bien cette tendance.
Le Royaume-Uni et le Brexit : un souverainisme électoral
L’un des événements les plus marquants du souverainisme contemporain est sans doute le Brexit. En 2016, les Britanniques ont voté à 51,9 % en faveur de la sortie de l’Union européenne, exprimant ainsi leur volonté de reprendre le contrôle de leurs lois, de leurs frontières et de leur politique économique.
Le slogan « Take back control » (« Reprenons le contrôle ») résume parfaitement l’état d’esprit qui a conduit à cette décision. Les partisans du Brexit dénonçaient la bureaucratie bruxelloise, la libre circulation jugée incontrôlable et les règles commerciales imposées par l’UE. Ce divorce avec l’Union a été difficile et laborieux, mais il illustre un choix radical : privilégier la souveraineté nationale, quitte à en subir les conséquences économiques à court terme.
Aujourd’hui, le Royaume-Uni navigue entre autonomie retrouvée et défis logistiques. Si certains aspects du Brexit sont critiqués, notamment sur le plan économique, il demeure une référence majeure pour les mouvements souverainistes en Europe.
La Hongrie de Viktor Orbán : un souverainisme identitaire et politique
En Europe centrale, la Hongrie s’affirme comme un bastion du souverainisme, sous l’impulsion de Viktor Orbán. Depuis son retour au pouvoir en 2010, Orbán revendique une politique d’indépendance face à Bruxelles, notamment en matière de justice, de contrôle des frontières et de politique migratoire.
Refusant les injonctions européennes sur l’accueil des migrants, il a instauré une politique de fermeté qui lui a valu de nombreuses critiques de la part de l’UE. Orbán défend également un modèle de « démocratie illibérale », où la souveraineté de l’État prime sur certains dogmes du libéralisme occidental.
Sur le plan économique, la Hongrie maintient une coopération avec l’Union européenne tout en cherchant des alliances alternatives, notamment avec la Russie et la Chine. Ce souverainisme pragmatique lui permet de jouer sur plusieurs tableaux, affirmant son indépendance tout en bénéficiant des avantages de son appartenance à l’UE.
Les États-Unis sous Donald Trump : « America First », le retour
Avec la réélection de Donald Trump en 2024 et son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, le souverainisme américain est à nouveau au premier plan. Dès son premier mandat (2016-2020), Trump avait marqué une rupture avec la politique globaliste en mettant en avant une approche protectionniste et nationaliste sous le slogan « America First ».
Son retour au pouvoir confirme cette ligne souverainiste, avec plusieurs annonces majeures dès les premiers jours de son mandat :
- Retour au protectionnisme : augmentation des droits de douane sur les importations chinoises et européennes, relance de la politique de « reshoring » pour rapatrier des industries stratégiques aux États-Unis.
- Réduction de l’implication dans les institutions internationales : critique renouvelée de l’OTAN, menace de désengagement de certaines agences onusiennes.
- Renforcement du contrôle migratoire : reprise du projet de mur à la frontière mexicaine, restrictions accrues sur l’immigration clandestine.
Si certains observateurs craignent un isolement des États-Unis sur la scène mondiale, d’autres estiment que cette posture souverainiste permet au pays de défendre ses intérêts sans subir les contraintes des organisations internationales.
D’autres modèles de souveraineté assumée
- La Russie de Vladimir Poutine : Depuis son arrivée au pouvoir en 2000, Poutine a recentré la Russie sur une politique de puissance souverainiste, s’opposant aux influences occidentales et cherchant à reconstruire une autonomie économique et stratégique.
- Le Brésil de Jair Bolsonaro : Durant son mandat (2019-2022), Bolsonaro a adopté une posture de rejet des institutions globales, notamment sur les questions environnementales, défendant l’exploitation autonome des ressources naturelles du pays.
- L’Inde de Narendra Modi : L’Inde développe un souverainisme pragmatique, en affirmant son indépendance économique et technologique tout en jouant un rôle clé sur la scène internationale.
Quelles leçons pour la France ?
Ces exemples montrent que le souverainisme peut prendre des formes variées : électoral (Brexit), identitaire (Hongrie), économique (États-Unis), ou encore géopolitique (Russie). Si la France voulait suivre une voie souverainiste, elle devrait sans doute trouver son propre modèle, adapté à ses réalités économiques, historiques et géopolitiques.
Cela poserait plusieurs questions stratégiques :
- Un Frexit est-il envisageable ? L’exemple du Royaume-Uni montre que quitter l’UE a un coût, mais offre aussi des opportunités.
- Une souveraineté économique est-elle possible ? La réindustrialisation et la relocalisation deviennent des priorités pour de nombreux États, mais nécessitent des investissements massifs.
- Comment articuler souverainisme et mondialisation ? La France peut-elle être souveraine tout en restant un acteur majeur du commerce international ?
Le débat reste ouvert, mais une chose est sûre : la question de la souveraineté est plus actuelle que jamais.
Le retour du souverainisme en France : entre héritage et renouveau
Le souverainisme s’impose aujourd’hui comme une réponse aux défis posés par la mondialisation et l’intégration européenne. À travers l’histoire, il a été le socle de la souveraineté nationale, garantissant aux peuples le droit de décider par eux-mêmes. En France, il est défendu par des intellectuels comme Michel Onfray et Paul Melun, qui, à travers Front Populaire et Souverains demain!, proposent une réflexion alternative face à un modèle européen perçu comme technocratique et éloigné des citoyens.
À l’international, plusieurs pays ont fait le choix d’un souverainisme assumé. Du Brexit britannique au protectionnisme américain de Donald Trump, en passant par la Hongrie de Viktor Orbán, ces exemples montrent qu’il est possible de défendre ses intérêts nationaux sans céder aux dogmes du mondialisme. Cependant, chaque expérience présente des défis, et la France, si elle souhaitait suivre cette voie, devrait adapter le souverainisme à ses propres réalités économiques et géopolitiques.
Le débat reste ouvert : faut-il envisager un Frexit ? Comment réindustrialiser le pays tout en restant compétitif à l’échelle mondiale ? Jusqu’où pousser la rupture avec les institutions européennes ? Le souverainisme, loin d’être un simple réflexe identitaire ou nostalgique, pourrait bien être une clé pour redonner à la France sa capacité de décision et sa place dans le concert des nations.
Dans un monde en crise, marqué par les tensions géopolitiques et les bouleversements économiques, la question n’est peut-être plus de savoir si le souverainisme est une option, mais s’il est devenu une nécessité.
VOUS POURRIEZ AIMER : Centralisation ou fédéralisme : quel modèle assure la prospérité des nations ?