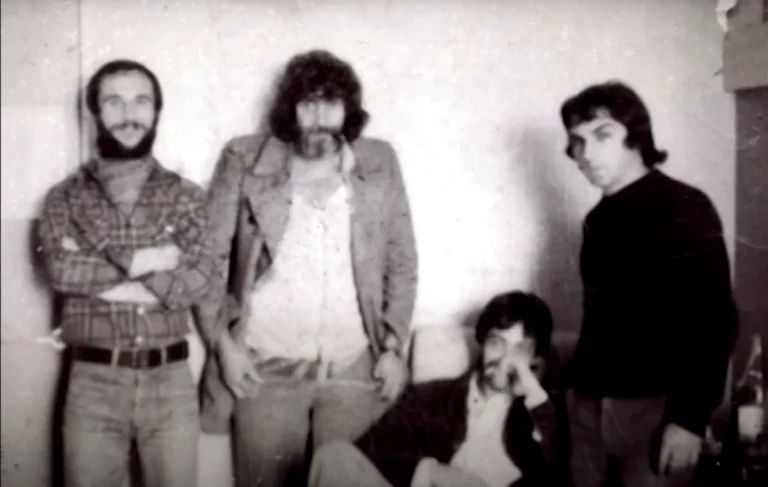Le deux poids deux mesures médiatique : enquête sur le « privilège rouge »
Dans le paysage politique et médiatique français, un constat revient régulièrement : le traitement différencié des discours et des actions selon qu’ils émanent de la droite ou de la gauche. L’avocat et essayiste Gilles-William Goldnadel a forgé une expression pour qualifier cette asymétrie : le « privilège rouge ». Par cette formule, il dénonce ce qu’il considère comme une indulgence systématique des médias et de certains milieux intellectuels envers les débordements de l’extrême gauche, tandis que des propos ou actes similaires venant de la droite seraient immédiatement voués aux gémonies.
Cette perception est au cœur de nombreux débats sur la liberté d’expression, le rôle des médias et l’équilibre du débat démocratique. Les critiques dénoncent une tendance à minimiser ou justifier les excès de la gauche radicale, là où ceux de la droite suscitent des réactions immédiates et virulentes, souvent accompagnées de campagnes de disqualification.
Cet article propose d’explorer cette notion de « privilège rouge » en s’appuyant sur des exemples concrets et en questionnant l’impact de cette asymétrie sur la qualité du débat public.
Origine et définition du concept
Le terme « privilège rouge » a été popularisé par Gilles-William Goldnadel, avocat et essayiste engagé dans la critique des biais médiatiques. Régulièrement invité sur les plateaux de CNews et contributeur au Figaro Vox, Goldnadel dénonce ce qu’il perçoit comme une partialité systémique dans le traitement des idéologies politiques en France.

Selon lui, l’extrême gauche bénéficierait d’une bienveillance médiatique et judiciaire, tandis que la droite et, a fortiori, l’extrême droite, seraient scrutées avec une rigueur implacable. Cette indulgence se traduirait par des silences coupables face à des propos violents, des actes de censure, voire des atteintes physiques, lorsqu’ils émanent de militants ou personnalités d’extrême gauche.
Goldnadel illustre son propos en comparant la réaction médiatique à des dérapages similaires selon qu’ils viennent de la gauche ou de la droite. Dans une tribune publiée dans Le Figaro, il cite des cas où des personnalités de droite ont été massivement attaquées et ostracisées pour des propos jugés polémiques, tandis que des déclarations équivalentes à gauche passent sous silence ou sont relativisées.
Ce concept s’inscrit dans une critique plus large du monopole moral revendiqué par une certaine gauche intellectuelle et médiatique. Pour Goldnadel et ses partisans, ce privilège rouge fausse le débat démocratique en instaurant une asymétrie idéologique dans l’espace public.
Illustrations du privilège rouge
L’accusation d’un traitement différencié entre extrême gauche et droite ne repose pas uniquement sur une impression subjective. Plusieurs cas concrets viennent illustrer cette asymétrie dans les réactions médiatiques et politiques.
Les menaces entre députés
Un exemple frappant de cette indulgence concerne les menaces proférées par certains députés de La France Insoumise à l’encontre de leurs collègues du Rassemblement National. À plusieurs reprises, des élus LFI ont tenu des propos agressifs visant directement des députés RN, allant jusqu’à suggérer qu’ils ne méritaient pas d’être considérés comme des interlocuteurs légitimes. Pourtant, ces déclarations n’ont pas suscité de tollé médiatique comparable à celui qui aurait suivi des propos similaires venant de l’extrême droite.
Agressions physiques et violences militantes
Les violences physiques commises par des militants d’extrême gauche contre leurs adversaires politiques sont un autre exemple marquant. En avril 2024, Stanislas Rigault, président de Génération Z (branche jeune de Reconquête), a été agressé en pleine rue par des militants antifascistes. L’événement a été peu relayé et a suscité des réactions politiques discrètes. À l’inverse, lorsque des violences sont attribuées à des militants d’extrême droite, elles font généralement la une des médias et entraînent des condamnations unanimes.
Propos antisémites et polémiques à gauche
Certains élus et militants d’extrême gauche ont été accusés d’entretenir une rhétorique ambiguë sur l’antisémitisme, notamment à travers des déclarations liées au conflit israélo-palestinien. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a tenu plusieurs propos dénoncés par des organisations juives, mais ces controverses n’ont pas eu d’impact politique durable sur lui ou sur son mouvement. En comparaison, des figures de droite accusées d’ambiguïtés similaires ont souvent vu leur réputation durablement entachée.
Dégradations et violences lors de manifestations
Lors des manifestations contre la réforme des retraites ou d’autres mouvements sociaux, des groupes d’extrême gauche ont commis des actes de vandalisme et des agressions contre les forces de l’ordre. Ces violences sont souvent présentées comme des « débordements » ou mises sur le compte de la radicalisation d’une frange minoritaire. En revanche, lorsque des troubles à l’ordre public impliquent des militants de droite ou d’extrême droite, ils sont généralement traités avec bien plus de sévérité, tant sur le plan médiatique que judiciaire.
Appels à la censure et à l’exclusion médiatique
Certains intellectuels et personnalités médiatiques de gauche ont ouvertement appelé à la censure de figures de droite sous prétexte de lutte contre les discours haineux ou réactionnaires. Paradoxalement, ces appels à restreindre la liberté d’expression sont rarement dénoncés comme des atteintes au pluralisme démocratique, alors qu’un appel équivalent venant de droite susciterait immédiatement des accusations d’autoritarisme.

Ces exemples permettent de mieux comprendre ce que Gilles-William Goldnadel désigne par « privilège rouge » : une tolérance sélective aux excès politiques selon leur provenance idéologique.
Le traitement médiatique différencié
L’un des éléments clés du « privilège rouge » réside dans la manière dont les médias couvrent les controverses en fonction de l’idéologie des protagonistes. Plusieurs mécanismes contribuent à cette asymétrie :
La différence de tonalité et de couverture
Lorsqu’un dérapage est commis par une personnalité de droite, il fait souvent l’objet d’une forte amplification médiatique, avec des titres alarmistes et des analyses dénonçant une montée des extrêmes. En revanche, lorsque des faits similaires concernent l’extrême gauche, la couverture est souvent plus neutre, minimisante, voire absente.
➡ Exemple : La condamnation massive des propos jugés racistes ou sexistes venant de personnalités de droite contraste avec la relative indulgence médiatique face à certaines déclarations de militants de gauche, notamment sur des sujets comme l’antisémitisme ou les violences contre les forces de l’ordre.
La sélection des experts et des analystes
Dans de nombreux débats télévisés ou articles d’analyse, les médias tendent à privilégier des experts ou éditorialistes issus du même spectre idéologique, ce qui crée un effet de chambre d’écho. Ce biais structurel empêche souvent une remise en question de certaines idées dominantes à gauche et contribue à l’invisibilisation des controverses impliquant l’extrême gauche.
➡ Exemple : La montée de la violence dans certaines manifestations est souvent analysée sous un prisme compréhensif lorsqu’elle vient de la gauche (révolte légitime, colère sociale), alors que toute violence attribuée à l’extrême droite est immédiatement jugée comme une menace démocratique.
L’indulgence envers certaines formes de radicalité
Les médias ont tendance à présenter les figures de l’extrême gauche sous un angle romantisé : des militants engagés, des défenseurs des opprimés, voire des héritiers des luttes historiques. À l’inverse, l’extrême droite est systématiquement associée à un danger pour la démocratie, avec un rappel constant aux heures sombres du XXe siècle.
➡ Exemple : Dans certains reportages, des figures radicales comme Jean-Luc Mélenchon ou certains militants antifascistes sont décrits comme de « fervents opposants », tandis que leurs homologues à droite sont qualifiés de « figures controversées » ou de « personnalités sulfureuses ». Ce simple choix de vocabulaire oriente déjà la perception du public.
La censure et la hiérarchisation de l’information
Le « privilège rouge » se manifeste aussi dans ce que les médias choisissent de ne pas traiter. Certains sujets mettant en cause des groupes ou personnalités de gauche peuvent être sous-traités, voire occultés. En revanche, des polémiques mineures impliquant la droite peuvent être gonflées jusqu’à devenir des affaires d’État.
➡ Exemple : L’affaire Adrien Quatennens, impliqué dans des violences conjugales, a bénéficié d’une gestion médiatique bien plus discrète que des affaires similaires concernant des figures de droite. De même, des accusations graves pesant sur des élus LFI n’ont pas entraîné la même couverture que celles visant des personnalités du RN ou de Reconquête.
Objections et contre-arguments
Si le concept de « privilège rouge » trouve un écho chez de nombreux observateurs, il n’en demeure pas moins contesté. Plusieurs critiques s’opposent à cette vision et avancent des arguments pour nuancer ou remettre en question l’existence d’un tel déséquilibre médiatique.
L’idée d’un « privilège bleu marine » : un biais inverse ?
Certains critiques estiment que le RN et la droite conservatrice bénéficient aujourd’hui d’une banalisation médiatique. Selon eux, des figures de droite et d’extrême droite sont de plus en plus présentes dans les médias, bénéficiant d’une visibilité inédite. La normalisation du discours identitaire serait ainsi une contrepartie à l’influence supposée de la gauche radicale.
➡ Exemple : La montée en puissance de CNews et de figures comme Éric Zemmour ou Jordan Bardella est parfois présentée comme la preuve que les médias ne sont pas systématiquement biaisés en faveur de la gauche.
L’extrême droite, un danger historique avéré ?
Un autre argument avancé contre l’idée du « privilège rouge » est le fait que l’extrême droite porterait un passif historique plus lourd que l’extrême gauche. Le souvenir du nazisme et des régimes autoritaires fascistes justifierait une vigilance accrue contre les idées d’extrême droite, tandis que l’extrême gauche, malgré ses excès, ne représenterait pas un danger équivalent.
➡ Exemple : Les références constantes aux « heures sombres » lorsqu’on parle de mouvements de droite sont souvent justifiées par le fait que ces idées ont mené à des régimes totalitaires dans l’histoire.
Une réaction aux décennies de domination culturelle de la droite ?
Certains analystes considèrent que le traitement favorable de la gauche radicale dans certains médias ne serait qu’un contrepoids historique après des décennies de domination idéologique par des penseurs conservateurs. Pour eux, ce basculement ne serait pas un privilège, mais une correction d’un ancien déséquilibre.
➡ Exemple : Jusqu’aux années 1970, une majorité de médias étaient plus conservateurs, ce qui aurait poussé à un rééquilibrage progressif en faveur des idées progressistes et d’extrême gauche.
Une indignation sélective selon l’idéologie de chacun
Enfin, une critique récurrente du concept de « privilège rouge » est qu’il relève d’une perception idéologiquement biaisée. Ceux qui dénoncent un deux poids deux mesures en faveur de la gauche seraient souvent eux-mêmes issus du camp conservateur et porteraient un regard partial sur les médias.
➡ Exemple : Certains intellectuels de droite dénoncent le silence des médias sur les violences d’extrême gauche, mais sont parfois peu enclins à reconnaître les excès commis par leur propre camp.
Quand l’indulgence médiatique favorise un camp : le privilège rouge en question
L’expression « privilège rouge », popularisée par Gilles-William Goldnadel, désigne une asymétrie dans le traitement médiatique et politique des extrêmes. Selon cette thèse, l’extrême gauche bénéficierait d’une indulgence particulière, alors que la droite et l’extrême droite feraient face à une vigilance et une condamnation systématiques.
Les exemples analysés – des menaces entre députés, des violences politiques, des propos polémiques minimisés et des traitements médiatiques différenciés – montrent en effet des disparités dans la manière dont certains actes sont perçus et sanctionnés selon leur origine idéologique.
Toutefois, cette analyse est contestée par ceux qui estiment que l’extrême droite demeure un danger plus grand historiquement, ou que la droite elle-même bénéficie d’une certaine normalisation médiatique. Ce débat met en lumière un enjeu plus large : la nécessité d’un traitement équilibré des idées politiques, quelle que soit leur orientation.
Dans un contexte où les médias jouent un rôle crucial dans la formation de l’opinion publique, cette question dépasse le simple cadre du « privilège rouge » pour interroger l’impartialité du journalisme et la possibilité d’un débat démocratique authentique.
VOUS POURRIEZ AIMER AUSSI : Le debunking : une arme contre la désinformation, mais à quel prix ?