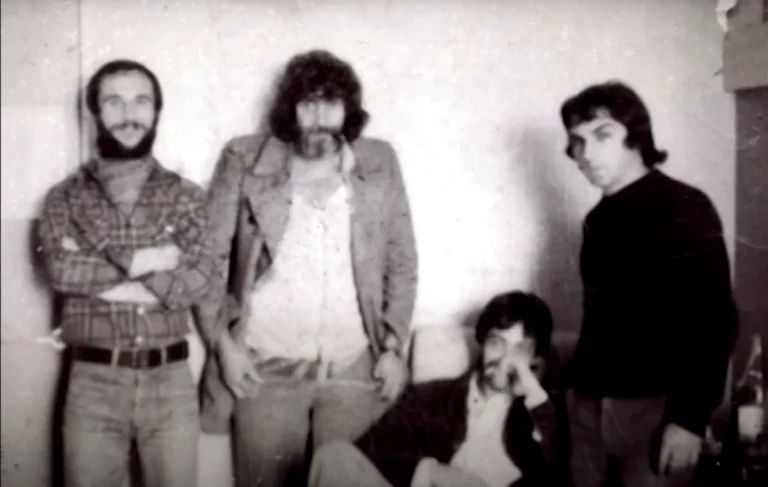La hausse de l’insécurité des femmes en France : Un cri d’alarme
La violence : une essence profondément ancrée dans l’humain
La violence entre les êtres humains n’est pas un phénomène nouveau. Elle est présente depuis les premiers jours de l’humanité et a été le sujet de nombreuses réflexions philosophiques et scientifiques. Selon le biologiste Henri Laborit, la violence infligée aux autres est une réponse naturelle au stress enduré. Dans son étude des comportements humains, Laborit suggère que notre tendance à la violence découle de notre essence même en tant que mammifères sociaux. Lorsque confrontés à des situations stressantes, nous avons tendance à réagir par la fuite, la lutte ou l’inhibition. Si la fuite est impossible et que la lutte est risquée, l’inhibition peut conduire à des actes de violence.
Cette idée fait écho à la pensée de Thomas Hobbes, qui, dans son ouvrage « Le Léviathan », postulait que l’état naturel de l’homme est un état de guerre de tous contre tous. Hannah Arendt, de son côté, a exploré la nature de la violence, en particulier la violence bureaucratique et institutionnelle. Elle a introduit le concept de « la banalité du mal », suggérant que des actes horribles peuvent être commis par des individus ordinaires, souvent sans malice ou intention malveillante. Cette idée est particulièrement pertinente lorsqu’on considère la violence systémique à laquelle sont confrontées de nombreuses femmes. René Girard a également apporté une perspective unique sur la violence avec sa théorie du désir mimétique. Selon Girard, la violence émerge de la rivalité et de l’imitation. Les sociétés utilisent souvent le mécanisme du bouc émissaire pour canaliser et purger leur violence collective. Cette théorie peut aider à comprendre pourquoi certaines victimes, comme les femmes, sont souvent ciblées de manière disproportionnée.
Toutefois, il est crucial de noter que, bien que la violence puisse être inhérente à la nature humaine, toutes les victimes ne sont pas égales face à elle. Les femmes, en particulier, semblent en souffrir de manière disproportionnée. La question demeure : pourquoi cette inégalité persiste-t-elle et comment pouvons-nous y remédier?
I. Les violences faites aux femmes : un phénomène en hausse
Les chiffres officiels montrent une réalité alarmante concernant les violences faites aux femmes en France. L’écart entre les sexes est frappant, et les femmes sont nettement plus souvent victimes de violences domestiques, d’agressions sexuelles et de féminicides.
Violences mortelles :
- En 2021, 122 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire, contre 23 hommes.
- 14 enfants mineurs ont été tués par un de leurs parents dans le contexte de violences conjugales.
- 82 % des victimes de morts violentes au sein du couple sont des femmes.
Violences conjugales :
- Entre 2011 et 2018, les violences conjugales ont touché en moyenne 295 000 victimes chaque année en France métropolitaine. 72 % de ces victimes étaient des femmes, soit 213 000 femmes.
- En 2020, 125 morts violentes au sein du couple ont été recensées, dont 102 étaient des femmes.
- Les forces de sécurité ont enregistré 159 400 victimes de violences conjugales en 2020, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2019. 87 % de ces victimes étaient des femmes, soit 139 200 femmes. Depuis 2017, les faits de violence conjugale enregistrés ont augmenté de 42 %.
Violences strictement sexuelles :
- Entre 2016 et 2018, les violences strictement sexuelles ont touché en moyenne 294 000 victimes chaque année en France métropolitaine, soit 0,7 % de la population âgée de 18 à 75 ans. 81 % de ces victimes étaient des femmes.
- 31 % des victimes ont déclaré avoir subi un viol et 14 % une tentative de viol.
- Dans 28 % des cas, le conjoint ou l’ex-conjoint était l’auteur des violences sexuelles. Concernant les viols ou tentatives de viol, 90 % des femmes adultes victimes connaissaient leur agresseur, et dans 45 % des cas, il s’agissait du conjoint ou de l’ex-conjoint.
Violences sexuelles sur mineurs :
- Selon l’enquête de l’Ined, 56 % des femmes et 76 % des hommes ayant déclaré avoir subi un (ou des) viol(s) ou tentative(s) de viol ont été agressés pour la première fois avant 18 ans. 40 % des femmes et 60 % des hommes ont été agressés avant 15 ans.
- En 2020, parmi les violences sexuelles sur mineurs enregistrées par les forces de sécurité, une agression sur trois a eu lieu dans le cadre du cercle familial, et 81 % des victimes étaient des filles.
Ces données montrent l’urgence de prendre des mesures pour lutter contre ce fléau et protéger les femmes et les filles en France.
II. Faut-il vraiment agir ?
Certains pourraient arguer, de manière provocatrice, qu’il ne faut rien faire. Après tout, le néoféminisme prône l’égalité absolue entre les sexes, sans distinction. Alors, pourquoi se soucier spécifiquement des femmes ? N’est-ce pas contradictoire ?
Mais cette perspective est réductrice. Être féministe, c’est reconnaître les inégalités et lutter pour les éliminer. Le néoféminisme n’est pas l’alpha et l’oméga de la lutte contre les discriminations sexistes : on peut être féministe à la française, tout en courtoisie et galanterie, et se dire qu’à défaut d’avoir des politiques assez courageux pour agir concrètement pour la sécurité des femmes, on pourrait promouvoir l’autodéfense pour les femmes, leur donnant ainsi les moyens de se protéger.
Conclusion
La hausse des violences faites aux femmes en France est un problème grave qui nécessite une action immédiate. Si la violence peut être inhérente à la nature humaine, cela ne signifie pas que nous devons l’accepter passivement. En tant que société, nous avons le devoir de protéger les plus vulnérables parmi nous et de lutter pour un monde plus sûr pour tous.