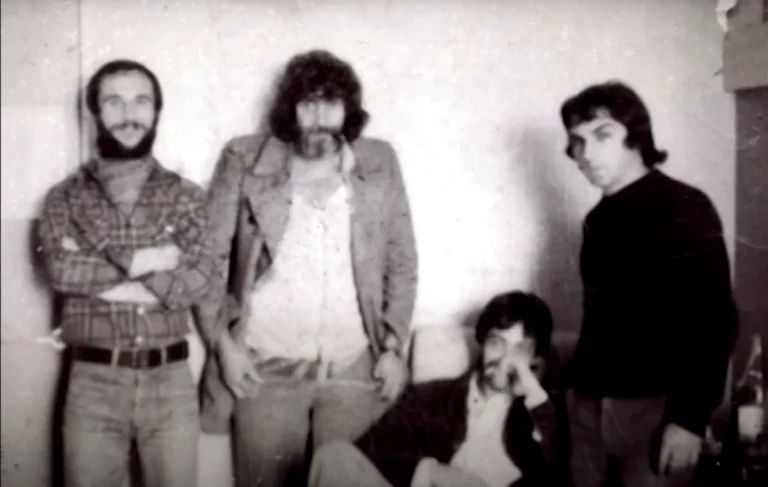Idéaux et reniements : la longue agonie de la gauche française
La gauche française. Un rêve, une promesse, un combat. Depuis la Révolution, elle a incarné l’émancipation, la justice sociale, l’égalité. Mais aujourd’hui, que reste-t-il de cet idéal ? Entre trahisons, compromissions et reniements, le grand récit de la gauche a viré au cauchemar. Mitterrand a pactisé avec le libéralisme. Hollande a enterré les dernières illusions. Aujourd’hui, le Nouveau Front Populaire (NFP) n’est que la dernière mascarade en date : une coalition de façade où chacun trahit un peu plus l’idée même de la gauche.
On aurait pu espérer un renouveau avec Raphaël Glucksmann, auréolé de son succès aux européennes. Mais au lieu de rebâtir un véritable Parti socialiste, il s’est empressé de se fondre dans l’union forcée du NFP, au mépris de toute cohérence politique. Pendant ce temps, les classes populaires, autrefois cœur battant de la gauche, s’en détournent définitivement.
D’un côté, l’histoire d’une pensée qui a façonné la France ; de l’autre, celle d’un long naufrage. Entre admiration et ironie, explorons ce qu’a été – et ce que n’est plus – la gauche française.
L’idéal historique et théorique de la gauche française
Il fut un temps où être de gauche signifiait quelque chose. Une boussole morale, un engagement total, une vision du monde où la justice sociale primait sur les intérêts particuliers. Une histoire forgée dans le feu des révolutions et des luttes, portée par des figures qui, elles, ne transigeaient pas.
Une naissance dans le sang et les barricades
La gauche française naît dans la tourmente. 1789, c’est la grande fracture : l’Assemblée nationale se divise entre ceux qui défendent les privilèges et ceux qui réclament l’égalité. Déjà, être de gauche, c’est s’opposer aux puissants. Puis viennent 1848, la révolution ouvrière, la brève illusion d’une République sociale. 1871, la Commune de Paris : le peuple prend le pouvoir avant d’être massacré par Versailles. Chaque fois, l’espoir, la trahison, le sang.

Le XXe siècle : une gauche au pouvoir, mais pas encore au reniement
Avec Jean Jaurès, la gauche trouve son premier maître à penser. Pacifiste, socialiste, il tente d’empêcher la guerre de 14, mais meurt assassiné. Puis viennent les grandes conquêtes : le Front populaire (1936) donne aux ouvriers des congés payés et la semaine de 40 heures. La Résistance, elle, forge un programme radical : nationalisations, Sécurité sociale, État providence. La gauche, en ce temps-là, c’est le progrès.
Les années passent, et la gauche mute. Mai 68 lui donne des couleurs libertaires. Mendès France tente une troisième voie entre capitalisme et socialisme d’État. Mais déjà, le poison de la compromission s’infiltre.
Les grandes valeurs : justice sociale, émancipation, une vision fluctuante du monde
Historiquement, la gauche s’est construite sur trois piliers :
- La justice sociale : défendre les ouvriers, les précaires, ceux que le capitalisme broie.
- L’émancipation individuelle et collective : l’école pour tous, la laïcité, la culture comme arme de libération.
- Un rapport ambigu au nationalisme et à la colonisation : si la gauche révolutionnaire de 1789 prône l’égalité des peuples, elle se divise ensuite. Jules Ferry, figure républicaine, défend l’empire colonial au nom de la « mission civilisatrice ». À l’inverse, Jaurès et les socialistes s’opposent aux conquêtes impérialistes, tandis que le Parti communiste deviendra un soutien majeur des mouvements anticoloniaux après 1945.
Pendant presque deux siècles, ces principes ont guidé son action. Puis vint le grand tournant…
La dérive contemporaine de la gauche : reniements et naufrage
La gauche avait un idéal. Elle avait des luttes. Elle avait un peuple. Aujourd’hui, elle a des communicants, des « valeurs de la République » brandies comme des incantations vides, et des alliances de circonstance dictées par l’urgence électorale. Entre reniements économiques, fracture avec les classes populaires et errance idéologique, la gauche française s’est sabordée.
1983 : le grand tournant mitterrandien
L’histoire du reniement commence en 1983, sous François Mitterrand. Après avoir promis la rupture avec le capitalisme, il fait machine arrière. La gauche entre dans l’ère du « tournant de la rigueur » : austérité, ouverture aux marchés, abandon des nationalisations massives. Une première trahison, justifiée au nom de « l’Europe » et du « réalisme économique ». En réalité, c’est le début d’une mutation : la gauche cesse d’être populaire et ouvrière, elle devient gestionnaire et technocratique.
Mitterrand, figure ambivalente, laisse un héritage empoisonné. Lui qui avait séduit l’électorat de gauche avec des promesses de transformation sociale lègue une gauche désidéologisée, où le pouvoir compte plus que les principes.
François Hollande : le socialisme sans le socialisme
Si Mitterrand a fait du libéralisme économique un passage obligé, François Hollande l’a assumé pleinement. Président de gauche élu en 2012 sur la promesse d’un ennemi — la finance — qu’il n’a jamais combattu, il parachève l’alignement du PS sur les dogmes économiques néolibéraux. Loi Travail, CICE (cadeaux fiscaux aux entreprises), renoncements en série : la gauche devient indistincte du centre-droit. Résultat ? Une base électorale en ruine et une porte grande ouverte à l’ascension de Jean-Luc Mélenchon, qui capte l’électorat populaire en se posant en héritier trahi du socialisme historique.
Le Nouveau Front Populaire : mascarade et fausse union
- Après la dissolution surprise de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron, la gauche n’a que quelques jours pour s’unir. Elle ressuscite dans la précipitation un Nouveau Front Populaire (NFP), alliance improbable entre Insoumis, écologistes, communistes et un Parti socialiste exsangue. Mais derrière l’affichage unitaire, tout sonne faux.

Pourquoi ?
- Une alliance de survie, non une alliance de principes : le NFP ne repose pas sur un projet commun mais sur la peur du pire (Macron, Le Pen). L’union est forcée, le programme est un collage hétéroclite de revendications contradictoires.
- Le problème Mélenchon : rejeté par une partie de la gauche pour ses méthodes autoritaires et ses dérives populistes, mais incontournable électoralement, il reste un poids mort que personne n’ose vraiment assumer ni évincer.
- Un décalage avec les classes populaires : le NFP parle beaucoup d’écologie et de questions sociétales, mais que dit-il aux ouvriers et employés frappés par l’inflation, la précarité et l’explosion des loyers ? Rien qui les ramène vers lui.
Glucksmann : l’illusion du renouveau
Il aurait pu incarner autre chose. Raphaël Glucksmann, européen convaincu, opposé aux excès mélenchonistes, a réalisé un bon score aux européennes. L’occasion parfaite pour refonder un vrai Parti socialiste, recentré sur ses valeurs historiques. Mais au lieu de s’émanciper, il s’est engouffré dans le NFP, sacrifiant son indépendance sur l’autel du « rassemblement ». Une occasion manquée, une de plus.
Conclusion : la gauche peut-elle renaître ?
La gauche française a longtemps été une force d’émancipation et de progrès. Mais à force de compromis, de renoncements et d’alliances improbables, elle s’est vidée de sa substance. Du tournant libéral de Mitterrand au socialisme sans socialisme de Hollande, jusqu’au Nouveau Front Populaire, ultime simulacre d’unité, elle a perdu son peuple, son idéal et sa capacité à incarner une alternative crédible.
Alors, peut-elle renaître ? Pas dans sa forme actuelle. Si une gauche authentique doit émerger, elle devra rompre avec les ambiguïtés, parler à nouveau aux classes populaires, et cesser d’être une simple variable d’ajustement pour empêcher la droite ou l’extrême droite de gouverner. Mais en l’état, ce n’est plus une gauche : c’est une coquille vide qui continue de flotter, sans cap, sur l’océan du reniement.