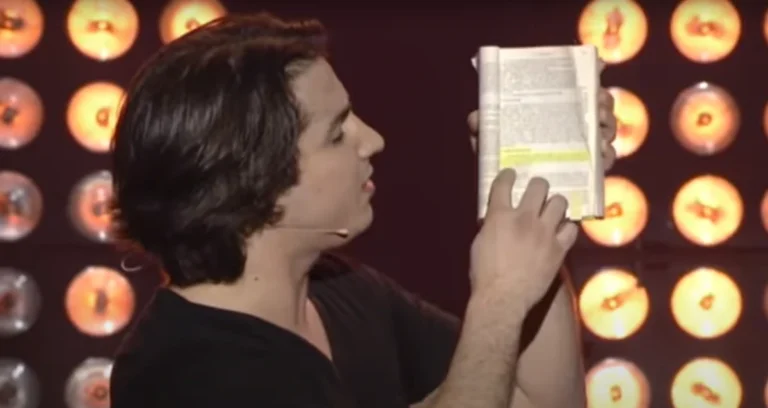Funny Games est un film de Michael Haneke sorti en 1997, souvent cité parmi les œuvres les plus radicales du cinéma européen contemporain. Derrière ce titre trompeusement anodin se cache un thriller psychologique glaçant, où la violence n’est jamais gratuite, mais toujours signifiante. Si vous cherchez un film qui interroge frontalement notre rapport au divertissement, à la souffrance et au voyeurisme, Funny Games est un passage obligé. Mais attention : cette expérience cinématographique ne se consomme pas à la légère.
Infos techniques et crédits
Titre : Funny Games
Réalisateur : Michael Haneke
Scénario : Michael Haneke
Année de sortie : 1997
Pays : Autriche
Durée : 108 minutes
Genre : Thriller psychologique, horreur
Voir le film sur Canal + VOD
Acteurs principaux :
- Susanne Lothar (Anna)
- Ulrich Mühe (Georg)
- Arno Frisch (Paul)
- Frank Giering (Peter)
Musique : Peu de bande originale, mais une utilisation marquante de Bonehead de John Zorn en ouverture et en clôture
Directeur de la photographie : Jürgen Jürges
Production : Wega Film
Distribution : Concorde-Castle Rock/Turner
L’actualité de Michael Haneke en 1997
En 1997, Michael Haneke est déjà reconnu pour son exploration des thèmes de la violence et de l’aliénation dans la société moderne. Cette année-là, il présente deux œuvres majeures : Funny Games et The Castle.
Funny Games est sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes 1997, aux côtés de films tels que The Eel de Shōhei Imamura (qui remporte la Palme d’Or ex æquo) et The Sweet Hereafter d’Atom Egoyan. La projection de Funny Games suscite des réactions contrastées, une partie du public quittant la salle en raison de la violence psychologique intense du film.
Parallèlement, Haneke réalise The Castle, une adaptation du roman inachevé de Franz Kafka. Ce téléfilm, diffusé initialement à la télévision autrichienne, est également présenté au Festival international du film de Berlin en 1997. The Castle explore les thèmes de la bureaucratie oppressante et de l’absurdité de la quête humaine, reflétant l’intérêt constant de Haneke pour les structures sociales aliénantes.
Cette double actualité cinématographique en 1997 illustre la volonté de Michael Haneke de confronter le public à des réalités dérangeantes, en questionnant les conventions narratives et en explorant la noirceur de l’âme humaine.
Résumé, thèmes et mise en scène
Funny Games s’ouvre sur une séquence emblématique : une famille bourgeoise – Anna, Georg et leur fils Schorschi – roule vers leur maison de vacances en écoutant un blind test de musique classique. Soudain, la bande-son est brutalement interrompue par Bonehead de John Zorn, une explosion bruitiste qui annonce la dissonance radicale à venir.
À peine installés dans leur résidence estivale, les vacances tournent au cauchemar lorsque deux jeunes hommes, Peter et Paul, polis et bien habillés, s’introduisent chez eux sous prétexte d’emprunter des œufs. Rapidement, l’intrusion devient un jeu sadique, où la famille se retrouve séquestrée et torturée psychologiquement. Mais le plus glaçant réside dans l’attitude des bourreaux : souriants, affables, traitant la violence comme une distraction mondaine.
Le film joue avec les attentes du spectateur en refusant tout exutoire : pas de montée dramatique classique, pas d’héroïsme, pas de vengeance cathartique. Haneke déconstruit les codes du thriller en forçant son public à une position de malaise insupportable. L’un des moments les plus troublants est la scène du « chaud-froid » : un jeu enfantin utilisé comme instrument de terreur. La tension naît du contraste entre l’innocence de la règle et l’horreur de la situation.
Par sa mise en scène clinique, Haneke évite les effets de style traditionnels du cinéma d’horreur. Pas de musique pour souligner l’angoisse, pas de mouvements de caméra frénétiques. Tout est froid, statique, méthodique, renforçant la banalité du mal qui se joue à l’écran. Et lorsque Bonehead revient en clôture, il agit comme une gifle, rappelant que cette brutalité n’a pas de justification, ni de résolution.
Funny Games dans la filmographie de Haneke et dans l’histoire du cinéma
Funny Games marque un tournant dans la carrière de Michael Haneke. Avant ce film, il avait déjà exploré la violence latente dans la société avec Le Septième Continent (1989) et Benny’s Video (1992), mais ici, il pousse l’expérience à son paroxysme. Haneke ne se contente plus de dénoncer la violence : il l’impose au spectateur, le mettant face à son propre voyeurisme.
Le film s’inscrit dans une tradition du « cinéma de la cruauté », qui inclut des œuvres comme Salò ou les 120 Journées de Sodome (1975) de Pasolini ou Henry, Portrait of a Serial Killer (1986) de John McNaughton. Mais contrairement à ces films, Funny Games ne montre presque rien : tout repose sur la suggestion et l’anticipation, rendant la violence encore plus insoutenable.
Funny Games partage avec certains films extrêmes la volonté de plonger le spectateur dans un malaise existentiel profond. Cette approche est proche de celle décrite dans Les héritiers de David Lynch.
L’héritage de Funny Games se retrouve dans le cinéma post-2000, notamment dans le « New French Extremity » avec Martyrs (2008) ou Irréversible (2002), qui jouent eux aussi avec la capacité du spectateur à supporter l’horreur. Haneke lui-même réaffirmera son obsession pour la manipulation des images avec Caché (2005) et Le Ruban blanc (2009).
Ironiquement, Funny Games connaîtra une seconde vie en 2007 avec son remake américain, réalisé par Haneke lui-même, plan pour plan, avec Naomi Watts et Tim Roth. Une démarche intrigante, comme si le réalisateur voulait adresser directement son message au public américain, grand consommateur de violence cinématographique.
Quand regarder Funny Games ?
Vous pourriez choisir de regarder Funny Games un soir d’été, dans une maison de campagne, histoire de goûter pleinement à l’ambiance oppressante du film. Mais soyons honnêtes : ce serait une très mauvaise idée.
Mieux vaut voir Funny Games dans un moment où vous êtes prêt à une expérience radicale, une séance qui ne cherche ni à divertir, ni à rassurer. C’est le film idéal pour une introspection sur votre propre rapport à la violence au cinéma. Regardez-le après un Die Hard ou un Scream, pour mesurer la différence entre un thriller ludique et un film qui vous prend violemment à partie.
C’est aussi le choix parfait pour gâcher une soirée entre amis qui s’attendaient à un home invasion « fun ». Lancez-le après Panic Room ou The Strangers et observez le malaise s’installer. Ambiance garantie.
Enfin, pour les plus téméraires, regardez-le après une journée paisible, un dimanche après-midi, au calme… histoire de transformer cette quiétude en angoisse existentielle.
Pour prolonger la réflexion sur l’image et la cruauté, Under the Skin propose une approche froide et clinique de la prédation.