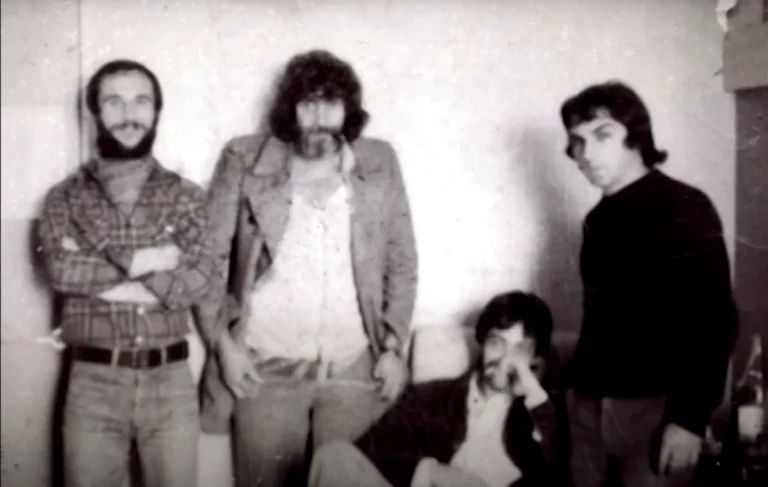L’anarchisme : entre rêve de liberté et impasse politique
Il y a des mots qui claquent comme une insulte. « Anarchiste » en est un. Tour à tour synonyme de chaos, de terrorisme ou d’idéalisme naïf, il évoque dans l’imaginaire collectif des bombes rondes à mèches, des barbus en haillons et des idéalistes criant « À bas l’État ! » devant des vitrines brisées. Pourtant, l’anarchisme est bien plus qu’un simple rejet de l’autorité. C’est une tradition politique, philosophique et sociale qui traverse les siècles, toujours portée par la même ambition : la liberté absolue de l’individu face aux structures oppressives.
À l’origine, l’anarchisme n’a rien du nihilisme qu’on lui prête parfois. Il est né d’un besoin viscéral de justice, d’un refus du joug de l’État, de la hiérarchie et de l’exploitation. Au fil du temps, il a pris mille visages : réformiste chez Proudhon, révolutionnaire chez Bakounine, scientifique chez Kropotkine, féministe et libertaire chez Emma Goldman. Il a engendré des luttes légitimes et héroïques, des expériences de vie fascinantes, mais aussi des excès sanglants et des impasses absurdes.
Alors, l’anarchisme est-il une force émancipatrice qui refuse de se soumettre aux carcans du pouvoir ? Ou une chimère idéologique, trop pure pour survivre au réel ? C’est ce que nous allons explorer à travers son histoire, ses figures majeures et son influence actuelle.
Les origines : De l’idée à l’action, la naissance d’un idéal de liberté
L’anarchisme n’est pas né d’un seul homme ni d’un seul événement. C’est un feu qui couvait sous la cendre depuis des siècles, une révolte instinctive contre le pouvoir et l’oppression, qui a fini par se structurer en théorie politique au XIXᵉ siècle. Avant d’avoir un nom, l’anarchisme était déjà là, tapi dans les replis de l’histoire.
Des racines anciennes
Bien avant que Proudhon ne revendique le terme, on trouve des traces d’idées anarchistes chez les cyniques de l’Antiquité, chez les hérésies médiévales, dans certaines communautés égalitaires et dans les écrits de figures radicales comme La Boétie. Son « Discours de la servitude volontaire » (1576) posait déjà cette question fondamentale : pourquoi obéit-on au pouvoir alors que nous sommes plus nombreux que lui ?
À l’aube de la modernité, William Godwin, philosophe anglais du XVIIIᵉ siècle, pose une première pierre fondatrice. Son essai Enquiry Concerning Political Justice (1793) défend une société sans gouvernement, où la raison et la coopération remplaceraient l’autorité et la coercition. Son influence est discrète mais réelle, annonçant ce qui va suivre.
L’acte de naissance : Proudhon et la déclaration de guerre à la propriété
C’est en 1840 que l’anarchisme prend officiellement son nom sous la plume de Pierre-Joseph Proudhon. Dans Qu’est-ce que la propriété ?, il lâche cette phrase devenue légendaire : « La propriété, c’est le vol. » Un pavé dans la mare. Pour lui, ce n’est pas l’État en soi qui est le problème, mais la domination économique, la soumission du travailleur au propriétaire et à l’employeur. Il prône un système mutualiste, fondé sur l’entraide et l’autogestion.
Proudhon n’est pas un révolutionnaire au sens classique. Il ne rêve pas d’un grand soir sanglant, mais d’une évolution progressive vers une société plus juste. Trop modéré pour les anarchistes radicaux, trop extrême pour les socialistes réformistes, il jette pourtant les bases d’un mouvement qui ne cessera de se diviser et de se réinventer.
La rupture : Bakounine et la fièvre révolutionnaire
Si Proudhon était un penseur, Bakounine était un incendie. Russe, exilé, conspirateur et tribun enflammé, il dynamite l’anarchisme en lui injectant une rage insurrectionnelle. Pour lui, l’État n’est pas réformable : il faut le détruire. Il s’oppose violemment à Marx au sein de la Première Internationale, rejetant toute idée de dictature du prolétariat. Là où les marxistes veulent conquérir le pouvoir, Bakounine veut l’abolir.
Avec lui, l’anarchisme cesse d’être une simple critique et devient un appel à la révolte immédiate. C’est une guerre ouverte contre l’ordre établi, qui mènera à la naissance de groupes clandestins, aux attentats et aux soulèvements anarchistes du début du XXᵉ siècle. Mais nous y reviendrons.
Les grandes figures : Proudhon, Bakounine, Kropotkine, Goldman… Qui a fait quoi ?
L’anarchisme n’a pas de chefs, mais il a des figures tutélaires, des penseurs et des combattants qui ont donné corps à l’idée. Certains ont tracé des voies théoriques, d’autres ont plongé dans l’action, et tous ont laissé une empreinte durable.
Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) : le penseur fondateur
Premier à se revendiquer anarchiste, Proudhon est un paradoxe ambulant. Fils de paysan autodidacte, il veut abolir la propriété privée… sans rejeter la petite propriété individuelle. Hostile à l’État… mais méfiant envers la révolution violente. Misogyne réactionnaire… mais précurseur du fédéralisme libertaire.
Avec son idée de mutualisme, il imagine une société d’autogestion où les travailleurs échangent librement leurs services sans intermédiaire capitaliste ni coercition étatique. Son influence est immense, notamment sur le syndicalisme révolutionnaire.
Mikhaïl Bakounine (1814-1876) : le révolutionnaire incendiaire
Si Proudhon réfléchit, Bakounine détruit. Exilé, emprisonné, évadé, toujours en fuite, il incarne l’anarchisme dans sa forme la plus explosive. Son idée fixe : abattre l’État, sans compromis. Il s’oppose violemment à Marx, dénonçant la dictature du prolétariat comme une future tyrannie bureaucratique.
Son anarchisme est insurrectionnel, viscéral, un mélange d’enthousiasme débridé et de stratégie opaque. Il meurt sans voir ses idées triompher, mais ses disciples poseront les bases de l’anarcho-syndicalisme.
Pierre Kropotkine (1842-1921) : l’anarchiste scientifique
Ancien prince russe devenu révolutionnaire, Kropotkine est l’intellectuel qui réhabilite l’anarchisme aux yeux du monde. Là où les marxistes voient l’histoire comme une lutte pour le pouvoir, lui y voit une dynamique d’entraide naturelle.
Dans L’Entraide, un facteur de l’évolution (1902), il démonte la vision darwinienne de la compétition et prouve que la coopération est une force biologique et sociale. Pour lui, le communisme libertaire – une société sans État où les ressources sont partagées librement – est la conclusion logique de l’histoire humaine.
Il inspire de nombreux mouvements, notamment en Espagne, mais son utopie peine à s’incarner sans basculer dans le chaos.
Emma Goldman (1869-1940) : la rebelle absolue
Goldman est l’archétype de l’anarchiste inflexible. Militante féministe, anticapitaliste, pacifiste et révolutionnaire, elle combat tout ce qui ressemble à une autorité. Expulsée des États-Unis en 1919, elle soutient la révolution russe avant de se retourner contre Lénine lorsqu’elle voit les dérives autoritaires du régime bolchevik.
Elle défend les droits des femmes, la contraception, l’amour libre et l’individualisme radical. Elle incarne une version de l’anarchisme qui refuse de choisir entre le combat social et l’émancipation individuelle.
Errico Malatesta (1853-1932) : l’anarchiste pragmatique
Italien, organisateur infatigable, Malatesta cherche toute sa vie un équilibre entre révolution et efficacité politique. Il comprend que l’anarchisme ne peut pas seulement être un cri de révolte : il doit proposer des alternatives concrètes. Il milite pour une approche plus souple, capable de s’adapter aux réalités locales.
Son influence est plus discrète, mais essentielle pour ceux qui veulent un anarchisme qui ne sombre ni dans l’utopie pure, ni dans la violence nihiliste.
Les luttes concrètes : L’anarchisme au service de la justice
Si l’anarchisme a souvent été perçu comme une philosophie de la destruction, il a aussi inspiré des luttes héroïques et des expériences sociales fascinantes. Quand il ne se perd pas dans l’incantation ou la violence aveugle, il devient une force d’émancipation.
L’Espagne de 1936 : l’utopie anarchiste en actes
C’est l’exemple le plus spectaculaire d’anarchisme appliqué. Lorsque la guerre civile éclate en 1936, les anarchistes de la CNT (Confédération nationale du travail) et de la FAI (Fédération anarchiste ibérique) prennent en main l’organisation de vastes pans du pays. En Catalogne et en Aragon, usines et terres sont collectivisées, la bureaucratie est abolie, et l’autogestion devient réalité.
Le modèle semble fonctionner : la production continue, les décisions se prennent à la base, et une société sans État voit le jour. Mais l’expérience se heurte à deux ennemis : la guerre contre Franco d’un côté, la trahison des communistes staliniens de l’autre. Accusés d’être un obstacle à la discipline militaire, les anarchistes sont réprimés et leur rêve s’effondre.
Les Zapatistes du Chiapas : un anarchisme indigène
En 1994, le sous-commandant Marcos et l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) surgissent du maquis mexicain pour défendre les droits des peuples indigènes contre l’État central. Inspiré par l’anarchisme, le mouvement rejette toute structure hiérarchique : pas de leader suprême, pas de parti, mais des assemblées locales qui gèrent elles-mêmes leur autonomie.
Ce n’est pas une utopie théorique : depuis 30 ans, des communautés zapatistes fonctionnent sans ingérence de l’État, mettant en place une autogestion concrète en matière d’éducation, de justice et d’économie. Leur slogan « Mandar obedeciendo » (commander en obéissant) résume bien leur approche horizontale du pouvoir.
Les squats, zones autonomes et collectifs modernes
Partout dans le monde, des expériences anarchistes continuent à fleurir. Des ZAD en France (Notre-Dame-des-Landes), aux squats autogérés comme l’Exarchia d’Athènes, en passant par les communautés libertaires du Rojava en Syrie, des groupes mettent en place des alternatives basées sur l’autonomie, l’entraide et l’action directe.
Bien sûr, toutes ces initiatives ne sont pas exemptes de contradictions : certaines sombrent dans le dogmatisme, d’autres s’épuisent dans l’isolement ou la marginalité. Mais elles prouvent que l’anarchisme, lorsqu’il est appliqué avec pragmatisme, peut être plus qu’un simple cri de révolte.
Les dérives : Quand l’anarchisme sombre dans la violence aveugle
L’anarchisme a toujours été tiraillé entre son idéal de liberté absolue et la tentation de l’action violente. Quand la rage contre l’État et le capital ne trouve plus d’exutoire dans l’organisation ou l’expérimentation sociale, elle se transforme parfois en nihilisme pur, en destruction pour la destruction. C’est là que l’anarchisme perd son âme et se change en prétexte à la terreur.
La vague d’attentats anarchistes (1880-1910) : la propagande par le fait
À la fin du XIXᵉ siècle, un courant d’anarchistes radicaux décide que la parole et l’organisation ne suffisent plus : il faut frapper le pouvoir directement. C’est la théorie de la « propagande par le fait » : des assassinats politiques et des attentats doivent servir d’électrochoc pour réveiller les masses.
Le résultat est un bain de sang. Entre 1881 et 1914, des anarchistes tuent le tsar Alexandre II, le président français Sadi Carnot, le roi d’Italie Humbert Ier, le président américain William McKinley. Des bombes explosent dans des cafés et des théâtres. Chaque attentat entraîne une répression féroce qui finit par anéantir les mouvements anarchistes eux-mêmes.
Ironie suprême : ces assassinats, censés abolir le pouvoir, ne font que renforcer l’appareil répressif des États.
Le nihilisme et la fascination du chaos
À mesure que les mouvements ouvriers et révolutionnaires s’organisent autour d’idéologies plus structurées (le marxisme, le syndicalisme, le socialisme démocratique), l’anarchisme se retrouve en partie capturé par des tendances nihilistes.
Dans certaines franges, l’anarchisme cesse d’être une théorie politique et devient une simple haine de toute autorité, de toute institution, voire de toute forme d’ordre. C’est ainsi qu’apparaissent des figures comme Ravachol ou Émile Henry, qui posent des bombes dans des lieux publics sans distinction entre oppresseurs et innocents.
Là, on ne parle plus d’un projet de société. On parle d’une pulsion destructrice qui finit par ressembler aux tyrannies qu’elle prétend combattre.
Les Black Blocs et l’anarchisme comme esthétique du chaos
Aujourd’hui encore, l’anarchisme est souvent réduit à l’image des Black Blocs, ces groupes vêtus de noir qui surgissent lors des manifestations pour affronter la police et briser des vitrines. Leur tactique : la confrontation directe, la destruction de symboles du capitalisme.
Si certains y voient une forme d’action directe, d’autres y perçoivent un simple défouloir, un exutoire pour une révolte qui n’a plus de projet. Ce qui était autrefois un mouvement structuré avec une vision politique devient parfois un simple rituel de confrontation urbaine.
L’état actuel : Une influence souterraine mais vivante
L’anarchisme n’a jamais triomphé en tant que système politique, mais il n’a jamais disparu non plus. Après les grands mouvements révolutionnaires du XIXᵉ et du début du XXᵉ siècle, il a muté, s’est infiltré dans d’autres luttes, s’est hybridé avec de nouveaux combats. Aujourd’hui, il survit sous d’autres formes, moins visibles mais toujours influentes.
L’anarchisme et les mouvements sociaux contemporains
L’anarchisme a profondément marqué la pensée politique moderne, notamment dans l’essor des luttes horizontales et autogérées. Des mouvements comme Occupy Wall Street, les Gilets Jaunes, Extinction Rebellion ou encore les mobilisations altermondialistes des années 2000 ont tous puisé dans l’héritage anarchiste : refus des leaders, prise de décision par consensus, méfiance envers les institutions.
Ces mouvements n’ont pas toujours abouti à des changements concrets, mais ils ont prouvé que l’anarchisme continue de vivre à travers les nouvelles formes de contestation.
Les communautés autogérées : un anarchisme du quotidien
Au-delà des manifestations et des affrontements politiques, l’anarchisme s’incarne aujourd’hui dans des expériences de vie en marge du système dominant. Les ZAD (Zones à Défendre), les squats autogérés, les coopératives de travailleurs, les réseaux de logiciels libres… autant d’exemples où l’autonomie et l’autogestion remplacent la hiérarchie et le marché.
Ces initiatives restent minoritaires, souvent précaires, mais elles montrent que l’idéal anarchiste n’a pas totalement sombré dans l’oubli.
Un héritage intellectuel toujours présent
Si l’anarchisme politique n’a jamais pris le pouvoir, il a gagné la bataille des idées sur certains points. Les débats sur la démocratie directe, la critique du pouvoir, la méfiance envers les institutions et le rejet des formes autoritaires de la gauche doivent beaucoup aux penseurs anarchistes.
Aujourd’hui, on ne voit plus de grandes figures anarchistes à la Bakounine ou Goldman, mais les idées circulent toujours : dans l’écologie radicale, dans les milieux queer et féministes, dans les nouvelles utopies post-capitalistes.
Une impasse stratégique ?
Le problème central de l’anarchisme reste le même depuis deux siècles : comment renverser un système sans en recréer un autre ? L’idée d’une société sans État, sans hiérarchie, où chacun s’organiserait librement, semble toujours aussi belle… et toujours aussi difficile à appliquer à grande échelle.
Là où le marxisme, malgré ses échecs sanglants, a su engendrer des régimes concrets, l’anarchisme, lui, n’a jamais dépassé le stade de l’expérimentation locale ou du soulèvement éphémère. Tant qu’il ne résout pas cette équation, il restera une force de contestation plus qu’un véritable projet de société.
Conclusion : L’anarchie, horizon atteignable ou fantasme romantique ?
L’anarchisme est une étoile filante dans l’histoire des idées politiques : flamboyant, fascinant, mais insaisissable. Il est l’expression ultime du refus de l’oppression, du rejet des hiérarchies et du rêve d’une liberté absolue. À travers les siècles, il a inspiré des combats légitimes, porté des utopies admirables et prouvé que l’autogestion et la coopération ne sont pas que des chimères.
Mais l’anarchisme est aussi son propre piège. Toujours rétif à l’organisation, hostile à toute prise de pouvoir, il échoue chaque fois qu’il s’approche du réel. Il brille dans la révolte, mais s’éteint dans la construction. Il inspire des mouvements, influence la pensée politique, infiltre le monde contemporain, mais reste condamné à une existence fragmentaire, éclatée, marginale.
Alors, l’anarchie est-elle possible ? Probablement pas à grande échelle. Mais comme source de contestation, comme laboratoire d’idées, comme refus des structures sclérosées, elle reste essentielle. Peut-être qu’au fond, l’anarchisme est condamné à ne jamais triompher – et c’est justement cela qui le maintient en vie.