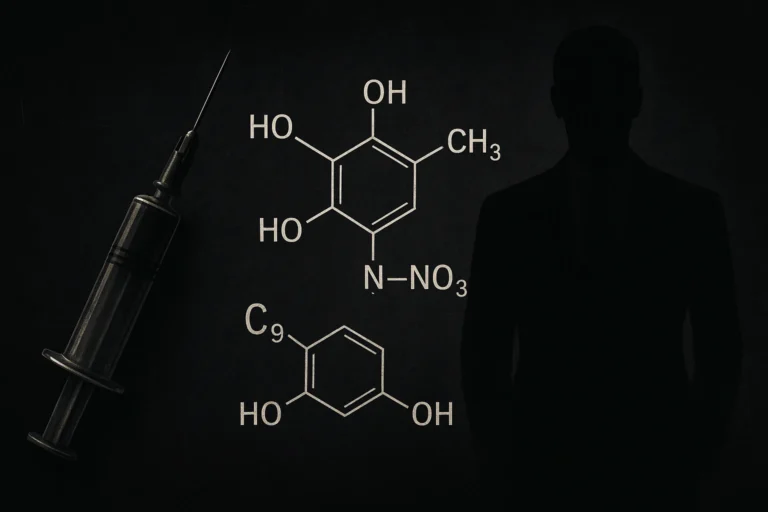« Vampire humaniste cherche suicidaire consentant » : quand le mythe dérape
Le vampire hante l’imaginaire collectif depuis des siècles, tapi entre mythe et réalité, fantasme et frisson. On le croit cantonné aux légendes d’Europe de l’Est ou aux romans gothiques, mais il se pourrait bien que certaines créatures nocturnes arpentent encore nos rues. Plus de dents acérées ni de capes dramatiques, mais une soif toujours intacte : celle du sang.
Nicolas Castelaux, ancien comédien, auteur et prisonnier, en est la preuve vivante – ou plutôt suintante. Dans ses mémoires, il raconte comment il a fait du vampirisme un mode de vie, une quête, un plaisir charnel. Buveur de sang assumé, il a trouvé des partenaires prêtes à lui offrir leur fluide vital, dans une relation oscillant entre érotisme et transgression. Mais où se situe la limite entre jeu et besoin ? Entre performance et pulsion incontrôlable ?
Car Castelaux n’est pas un cas isolé. Une véritable communauté de « vampires réels » existe, revendiquant le droit de boire du sang humain avec le consentement de leurs donneurs. Entre ésotérisme, recherche de pouvoir et pathologie médicale, ces pratiques posent une question fascinante et inquiétante : le vampirisme peut-il être une réalité biologique et psychologique, et non plus seulement une légende ?
Nicolas Castelaux, un vampire autoproclamé
On imagine souvent les buveurs de sang comme des marginaux nocturnes, échappés d’un roman d’Anne Rice, arborant lentilles rouges et capes de velours. Nicolas Castelaux, lui, est bien réel, et son histoire n’a rien d’une fiction romantique.
D’abord comédien, Castelaux a fréquenté le milieu gothique avant de sombrer dans une spirale plus obscure. Fasciné par la mort et les transgressions ultimes, il ne se contente pas d’un simple cosplay vampirique : il boit du sang, le réclame, le savoure comme une nécessité vitale. Ses mémoires témoignent d’un véritable rituel où l’acte de boire devient un moment sacré, intime et sensuel. Certaines de ses partenaires, loin d’être réticentes, partageaient même cette soif. Mais parlait-on d’un simple fétichisme, d’un pacte amoureux, ou d’une compulsion plus profonde ?
Son parcours l’a finalement mené à la prison. Non pas pour vampirisme, mais pour des faits qui témoignent d’une existence constamment attirée par l’interdit. Son témoignage reste rare : peu de « vampires » réels osent raconter leurs pratiques avec autant de détails et de sincérité. Pourtant, il n’est pas seul.
Le monde souterrain des vampires contemporains est bien plus vaste qu’on ne le pense. De New York à Paris, des individus revendiquent cette soif, souvent sous une forme codifiée, consentie et ritualisée. Mais à quel moment cesse-t-on d’être un acteur d’un fantasme pour devenir un prédateur ?
Les communautés de buveurs de sang
Si l’on croit encore que le vampirisme n’est qu’un fantasme de roman gothique, un tour d’horizon des communautés modernes de « vampires réels » suffit à prouver le contraire. Des groupes existent bel et bien, organisés, codifiés, parfois même structurés en véritables sociétés secrètes.
Les « vampires sanguins » se revendiquent comme tels et assurent ressentir un besoin physiologique de consommer du sang humain. Loin des clichés cinématographiques, ils n’arrachent pas les gorges au coin des ruelles sombres : leur pratique repose sur un consentement mutuel avec des « donneurs », souvent eux-mêmes fascinés par cette symbolique du don de soi. Certains parlent d’un rituel sacré, d’autres d’une addiction déguisée sous des airs mystiques.

Aux États-Unis, des figures comme Father Sebastian, autoproclamé maître du mouvement vampirique moderne, revendiquent une approche plus ésotérique, où le sang est un vecteur d’énergie et de connexion spirituelle. À l’inverse, d’autres groupes, plus secrets, s’enferment dans des pratiques troubles, où le désir de pouvoir et de domination prend le pas sur la simple « alimentation ».
Dans certains cas, ces communautés flirtent avec le BDSM, la subculture gothique et des croyances plus profondes sur la nature du sang comme essence vitale. Fascination esthétique ou symptôme d’un mal-être plus profond ? La frontière est mince, et le sujet dérange, car il questionne notre rapport à la transgression et aux pulsions primitives.
Vampirisme criminel : quand le fantasme vire au meurtre
Si la plupart des vampires modernes revendiquent des pratiques consenties, certains cas de vampirisme criminel franchissent la ligne du fantasme pour rejoindre les comportements des tueurs en série, mêlant pulsion de mort, ritualisation et mise en scène morbide. De la fascination pour le sang à l’horreur du crime, il n’y a parfois qu’un pas – ou quelques gouttes de trop. C.
Rod Ferrell et le clan des vampires
L’un des cas les plus célèbres est celui de Rod Ferrell, un adolescent américain qui, en 1996, a créé une « famille vampirique » avec des jeunes marginaux. Se prenant pour l’incarnation d’un vampire nommé Vesago, il a fini par commettre l’irréparable : le meurtre brutal du père d’une de ses adeptes. Ce crime, mêlant délire mystique et culte de la transgression, a choqué l’Amérique et alimenté les craintes autour des subcultures gothiques.
« Vampire humaniste cherche suicidaire consentant »
Mais parfois, l’horreur ne réside pas seulement dans l’acte lui-même, mais dans la manière dont il est mis en scène. Cette petite annonce, « Vampire humaniste cherche suicidaire consentant », aurait pu être un simple canular morbide. Mais derrière ces mots se cache une réalité plus troublante : celle de pactes où le don du sang devient un passage vers la mort.
En 2002, l’affaire Armin Meiwes, surnommé « le cannibale de Rotenburg », a révélé au grand public l’existence de forums où des individus cherchent à être consommés – littéralement. Si Meiwes n’était pas un vampire, le parallèle est évident : un désir d’absorption totale de l’autre, de fusion par la destruction. L’ombre du vampire rôde, bien loin du romantisme des romans.
Quand le mythe devient prétexte au crime
Il existe d’autres cas, plus discrets, où le vampirisme devient un alibi. Des meurtres rituels, des agressions où le sang est bu comme un trophée, des groupes où la domination psychologique pousse certains à se soumettre jusqu’à la mutilation. Ces dérives posent une question vertigineuse : à partir de quel moment un fantasme devient-il dangereux ?
Dans cette zone grise entre jeu de rôle, pathologie et pulsion criminelle, une certitude demeure : le vampire, même moderne, continue de terrifier.
Entre mythe et pathologie : faut-il prendre ces vampires au sérieux ?
Le vampirisme est-il un simple fantasme de marginal en quête de frissons, ou une réelle nécessité physiologique et psychologique ? La science, si elle ne valide pas l’existence de véritables buveurs de sang immortels, a identifié certains phénomènes troublants.
Le syndrome de Renfield : l’obsession du sang
Certains psychiatres parlent du syndrome de Renfield, du nom du personnage fou de Dracula qui buvait du sang d’animaux en pensant en tirer une force vitale. Ce trouble, rare mais bien documenté, décrit une obsession maladive pour l’ingestion de sang, souvent associée à des pulsions sexuelles et à des comportements compulsifs. Certains criminels vampiriques présentaient d’ailleurs ces symptômes, où la soif de sang devient une addiction aussi puissante que la drogue.
Troubles dissociatifs et pulsions incontrôlables
D’autres vampires autoproclamés souffrent de troubles dissociatifs ou de paraphilies où le sang devient un fétiche érotique. Dans ce cas, la consommation de sang relève plus du rituel symbolique que d’un besoin physiologique. Mais pour certains, la frontière est floue : des témoignages de « vampires sanguins » évoquent des symptômes proches de la dépendance, comme une fatigue intense lorsqu’ils sont privés de leur dose de sang. Effet placebo ou réalité biologique encore incomprise ?
Et si le sang avait réellement un pouvoir ?
D’un point de vue scientifique, le sang est une source de nutriments et d’hormones. Des recherches ont montré que des transfusions de sang jeune pouvaient rajeunir des souris âgées. De là à imaginer que boire du sang puisse procurer des bienfaits… il n’y a qu’un pas que certains franchissent volontiers.
Les vampires modernes jouent-ils un rôle ? Ou vivent-ils une réalité qui échappe encore aux classifications médicales ? Une chose est sûre : leur existence dérange, car elle nous renvoie à nos propres tabous sur la chair, la mort et l’absorption de l’autre.
Ce type de dérive fascine autant qu’il horrifie, et trouve aujourd’hui une résonance troublante dans le succès populaire du true crime, où le mal devient objet de spectacle.
Conclusion – Une transgression romantique ou une pulsion monstrueuse ?
Le vampire réel existe. Il n’a ni crocs surnaturels ni pouvoirs hypnotiques, mais il rôde, tapi dans les marges de la société. Qu’il s’agisse d’un simple jeu, d’un fétichisme érotique, d’un besoin pathologique ou d’une fascination morbide, le vampirisme moderne trouble parce qu’il franchit une frontière primale : celle du sang, fluide vital par excellence, symbole de la vie et de la mort.
Nicolas Castelaux et les buveurs de sang contemporains oscillent entre quête de puissance, besoin viscéral et théâtralisation du mal. Certains se contentent d’un rituel intime et codifié, d’autres sombrent dans la violence, et quelques-uns dépassent l’horreur en entraînant leurs victimes dans la mort. Où s’arrête la mise en scène ? Où commence la monstruosité ?
Au fond, le vampire continue de fasciner parce qu’il est un miroir de nos angoisses : peur du temps qui passe, du désir qui consume, de l’effacement de l’individualité dans la fusion avec l’autre. Que ce soit dans la fiction ou dans la réalité, il nous rappelle que certaines soifs ne s’éteignent jamais.